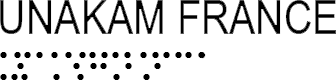Sur environ 80 000 masseurs-kinésithérapeutes, les malvoyants et aveugles représentent approximativement 2 000 confrères. Ce métier est l’un des rares qui leur permette d’exercer une activité professionnelle à part entière. Mais au quotidien, ce n’est pas si simple. Quelles sont leurs difficultés ? De quoi auraient-ils besoin pour travailler dans de meilleures conditions ?